AURIC Georges
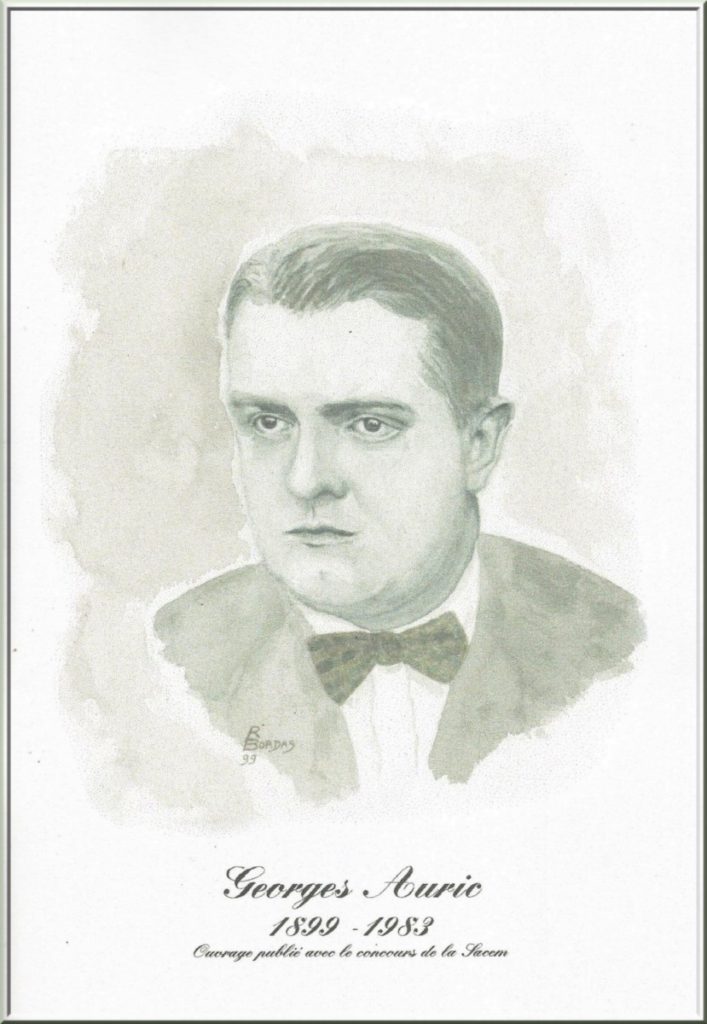
Georges AURIC, MUSICIENS FRANÇAIS no 4
◊ Aquarelle de Roselyne BORDAS ◊
GEORGES AURIC
Alexis Galpérine
Décembre 1999, mai 2018
Né quelques mois avant l’année 1900, Georges Auric s’est trouvé tout au long de sa vie au cœur des bouleversements qu’ont connus le monde de la musique et celui de l’art en général. La volonté autant que la détermination des événements ont fait de lui un acteur et un observateur privilégié de la création artistique d’un siècle qui s’achève aujourd’hui dans la plus grande incertitude. Il a voulu être de tous les combats, avide de connaître, de comprendre et de réveiller les tendances les plus originales de son temps, quand les fenêtres semblaient s’ouvrir en grand, jusqu’à ses dernières années où, refusant tout désenchantement, il continuait, encore et toujours, à guetter chez les jeunes compositeurs les lueurs d’un possible renouveau. La liste des rencontres et des amitiés qui ont jalonné son existence, véritable galerie de portraits de célébrités, apparaîtrait comme un simple catalogue mondain si on manquait d’y voir le signe évident d’un profond questionnement.
Auric n’avait pas quinze ans lorsqu’il quitta Montpellier pour venir à Paris et on ne peut qu’être frappé par l’étonnante maturité dont il faisait preuve à cette époque. L’étendue de ses connaissances musicales et littéraires était considérable et les lignes de force de sa personnalité étaient déjà en place. L’enfant ne connaissait pas seulement Debussy, Ravel, et même Stravinsky, il découvrait également l’œuvre de Satie, alors peu connu et surtout fort peu pris au sérieux. Il lisait les poètes symbolistes et s’enthousiasmait pour les Chants de Maldoror. Il plongea dans le fabuleux Paris de 1913 sans que s’impose à son sujet l’image attendue d’un Rastignac à l’assaut de la capitale et de la gloire. Son désir de pousser la porte du panthéon des grands hommes de son temps, qu’il avouera sans fausse pudeur, n’obéissait pas à d’autre impératif que celui d’étancher quelque peu la soif de sa curiosité. Ses goûts le guidaient d’instinct vers des mondes qui ne sont peut-être opposés qu’en apparence et qui, tous, révèlent ses aspirations à un idéal qui exclut, si ce n’est le brillant, du moins le mensonge. Les pédants, les vulgaires et les amers étaient soigneusement ignorés et ses pas le conduisaient avec une étonnante sûreté vers les sources d’inspiration les plus pures. A l’instar d’un Mauriac qui se comparait volontiers à un chat sachant choisir son panier, Auric sut admirablement et rapidement trouver le sien. Et s’il ne connut pas d’emblée ce qu’il recherchait, il sut par contre très tôt ce qu’il refusait.
Son rejet du conservatisme dans tous les domaines de la pensée n’a rien à voir avec l’audace que l’on prête à la jeunesse. Il s’agit d’un mouvement à la fois spontané et réfléchi qui, nous l’avons dit, l’accompagnera jusqu’à ses derniers jours. Pourtant Auric ne fut ni un révolté, ni un révolutionnaire, ni un homme de foi. On peut penser que, malgré ses engagements sincères, il n’eut jamais l’âme d’un militant. Il marcha, souvent en première ligne, sur le front des idées nouvelles mais sans porter l’étendard d’une cause sacrée et en conservant toujours cette sorte de retrait qui voilait son regard et inspirait le respect à ses compagnons d’armes. C’est précisément le refus de toute cause sacrée, assimilée au sectarisme qui tue la vie dans ses manifestations les plus diverses, qui a fondé son action et nourri sa sensibilité. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le sacré n’existait pas pour lui. Tout au contraire. Ce chercheur inlassable, si prompt à s’émerveiller des œuvres des autres et de tout ce qui en général heurtait l’ordre bourgeois, se méfiait des mirages de l’art dans ce domaine. Il détestait les chapelles et les gardiens du temple. Les combats, à ses yeux, ne pouvaient être que provisoires, c’est-à-dire sans cesse renouvelés, comme la vie elle-même. Pour lui le vrai visage de l’Absolu se cachait plus sûrement derrière le masque d’Arlequin que dans le cérémonial d’un art devenu lui-même un objet de culte. La distanciation par l’humour, la légèreté ou l’épure d’un dessin sans ombres – un croquis de Picasso ou une « Gymnopédie » de Satie – qui prône aussi bien une certaine forme d’ascétisme qu’une libération de la fantaisie par le refus de l’emphase métaphysique, sont les armes proclamées et bien connues du Groupe des Six. Et nous savons qu’Auric fut presque le coauteur du manifeste[1] de Cocteau qui tordait le cou au wagnérisme comme aux séductions trompeuses des derniers feux de l’impressionnisme. Au sein du Groupe, il occupa une place bien à lui dont il n’est pas facile de cerner les contours, peut-être parce qu’il échappe plus qu’un autre aux slogans réducteurs dont les Six eux-mêmes furent les principales victimes.
Il a été beaucoup dit, à juste titre, à quel point ces musiciens étaient de natures différentes, même si, à l’exception partielle d’Honegger, les caractéristiques dont il a été question se retrouvent dans leur musique et dans leur discours. Auric fut probablement celui dont la culture extra musicale était la plus profonde. La fréquentation assidue des peintres et des poètes lui était aussi nécessaire que celle des musiciens. Il ne les voyait pas en homme cultivé soucieux d’élargir ses connaissances, ou même en compositeur désireux de trouver à leur contact une source directe d’inspiration, mais bien pour pénétrer un peu plus les mystères de la création artistique et pour mieux dériver avec eux dans le courant d’une histoire qui les emportait vers l’inconnu. Un phénomène de lente imprégnation de l’âme d’un temps alimente son œuvre et donne, par-delà les modes et les influences qui jalonnent une époque, une saveur particulière à la traduction musicale de cette traversée du siècle. On sent bien que, chez lui, la littérature, la peinture ou la danse sont moins des excitants ponctuels à usage immédiat qu’un terreau où, d’une manière globale, s’enracinent son être et son art. Ce dernier viendrait après l’essentiel qui serait le questionnement et dont il serait l’émanation autant que la conséquence.
Il possédait au plus haut point le don très rare de l’amitié. On retrouve dans le recueil de ses souvenirs la réserve extrême de cet homme qui reconnaît s’être fait arracher ses confidences presque à contrecœur et qui sacrifie au rite du mémorialiste simplement parce que l’histoire ne lui appartient pas et qu’il pense nous devoir son témoignage. On devine que l’essentiel n’est pas dans ce qu’il dit, et qu’il ne veut, ou ne peut, rendre compte de ce mélange intime de tendre affection et d’échange fructueux qui fondent ce que Raïssa Maritain appelait les Grandes Amitiés : ce plaisir toujours renaissant de se voir qui transforme la moindre conversation en nourriture spirituelle, qui donne la joie pure du succès de l’autre, comme si l’admiration, loin de diminuer, augmentait la force de celui qui l’éprouve. Les non-dits sont ceux de l’amour vrai porté à des êtres qui, pour certains, sont devenus si célèbres qu’il est désormais impossible d’en parler, tant il est vérifié que le miroir déformant de la gloire rend irrémédiablement vaine toute tentative d’opposer un regard singulier à celui du public.
Pourtant la profusion même des grands artistes qu’Auric a côtoyés pourrait à première vue sembler presque suspecte. Est-il vraiment possible, sans posséder une âme de collectionneur, d’avoir été proche de Stravinsky, Picasso, Varèse, Diaghilev, Modigliani, Apollinaire, Jacques et Raïssa Maritain, Cendrars, Henri Pierre Roché, Derain, Aragon, Breton, Rouault, Picabia, Coco Chanel, d’avoir été le compagnon de route de Cocteau poète et cinéaste, un familier des ateliers de Braque et de Juan Gris, d’avoir dactylographié le manuscrit du Bal du Comte d’Orgel sous la dictée de son auteur, d’avoir été à ce point aimé de Max Jacob, encouragé à ses débuts par Satie, Ravel et Roussel, uni par la plus profonde complicité à Poulenc, Honegger et Milhaud, d’avoir assisté Léon Bloy dans ses derniers moments… et nous ne parlons que de la première partie de sa vie. Quel lien peut bien exister entre ces contemporains ? certains sont clairs, d’autres apparaissent comme inexistants. On voit les convergences et on aperçoit aussi les contradictions. Au rayon des antipathies déclarées citons Renan, Anatole France, les disciples de d’Indy… plus tous ceux qu’il évita délibérément et chez qui selon la belle formule de Schumann, le sérieux avait tué la gravité.
C’est la richesse même de ce temps qui explique la quantité et la valeur inestimable de ces rencontres. Contemplé depuis le fragile et modeste promontoire des derniers jours du XXe siècle, il donne presque le vertige et fait peut-être mesurer le nombre des promesses non tenues de ses débuts. Auric raconte le passage de ces années où l’art et la pensée avançaient par ruptures successives, à coups de refus et d’explorations hasardeuses, insatiables dans leur faim de découverte et leur désir d’innovation. Le compositeur s’efface et, sous le titre fantomatique de « Quand j’étais là », laisse se dérouler le film des événements en ne s’attribuant qu’un rôle, si ce n’est de simple figurant, du moins de silhouette attentive, de présence interrogative qui garde intact le secret de sa propre quête intérieure. Une ébauche de celle-ci apparaît en filigrane à travers les fils emmêlés des destins d’artistes qu’il évoque, sans donner toutes les clefs qui permettraient de remplir les pointillés, et en nous laissant le soin d’achever par nous-même, si cela est possible, le tracé de son parcours intellectuel et spirituel.
Une autre question s’impose d’elle-même à la lecture d’une vie, à ce point immergée dans le monde, avec son inévitable cortège d’obligations justement qualifiées de mondaines. C’est celle de l’autonomie de l’artiste exposé à trop d’influences diverses, à un nombre excessif d’individualités fortes qui entraînent dans leur sillage ceux qui les suivent, en réduisant peut-être la part la plus précieuse de ce qu’ils portent en eux. Nous savons bien que celle-ci est confrontée à l’impitoyable dilemme de la présence et de l’absence au monde; les excès de la tour d’ivoire étant aussi nocifs que le tourbillon d’activités qui distrait, au sens propre, des ressources fécondes de la vie intérieure. Le déchirement entre ces désirs contradictoires souligne ce que les contraintes du lien social peuvent avoir à la fois de nécessaire et de destructeur. Chez certains l’élan vers les autres l’emporte sur le repli sur soi. Le mouvement général alimente ainsi le moteur de l’action individuelle et se révèle même comme un remède contre les formes névrotiques que peut revêtir l’appel de la solitude. Et une variante de cette attitude « ouverte » peut même conjuguer le dénigrement des confrères avec leur fréquentation régulière ; la confrontation avec d’autres univers n’étant alors qu’un moyen de préserver le sien et même de le consolider par le jeu de l’opposition systématique. Mais, en tout état de cause, le dosage, avec ses réussites et ses échecs, est l’affaire de chacun, tout l’art étant de faire son miel avec le pollen environnant sans en altérer le goût.
Auric, sur ce point, est très représentatif d’une génération pour laquelle le groupe, la confraternité qui mêle les rêves de chacun dans le creuset de l’aventure collective, est un élément essentiel de l’activité créatrice. Cette génération chasse en meute et la mise en commun des aspirations individuelles n’est pas perçue comme un risque mais comme une stimulation permanente. On pourra à l’envie relativiser l’importance des convergences qui unissaient les musiciens du Groupe des Six, souligner le caractère accidentel de leur réunion, née en un soir de l’article inspiré d’Henri Collet, on ne pourra certainement pas considérer pour autant qu’elle fut un événement artificiel, une invention de journalistes en proie au démon du lancement publicitaire. L’action militante de Cocteau, qui a cimenté l’entente, ainsi que la figure tutélaire de Satie qui en a été l’âme fondatrice, sont bien connues et l’on hésite à y revenir. Mais on notera à quel point ces musiciens, solidaires dans la réalisation de leurs projets comme les mousquetaires de Dumas, marquent ainsi une rupture avec l’image de l’artiste romantique, solitaire et de préférence maudit, qui n’a cessé d’incarner l’archétype du génie depuis l’aube du XIXe siècle. Le phénomène revêt à cette époque un caractère nouveau, peut-être même unique, et Auric gardera toujours la nostalgie de ce temps, allant jusqu’à regretter, à la fin de sa vie, la disparition de cet état d’esprit chez les jeunes compositeurs qu’il côtoyait et encourageait ; le retour d’une certaine forme d’enfermement nombriliste lui apparaissant même comme un des périls qui menacent l’art contemporain. L’absence apparente, chez lui, de toute jalousie professionnelle, ou au moins de mentalité concurrentielle, est un des traits marquants de son caractère et c’est dans le cercle des compositeurs que s’étaient fixés ses plus grands attachements. Au premier rang de ceux-ci figure Francis Poulenc, celui sans nul doute qu’il a le plus aimé. Est-ce à dire qu’il se sentait suffisamment fort psychiquement pour ne pas redouter une dilution de sa personnalité dans une trop grande proximité avec le groupe ? Il semble clair dans son cas que l’on ne peut retenir l’hypothèse d’un excès de confiance en soi. Etait-ce alors un excès d’humilité ? Cela sonnerait certainement plus juste puisque cette qualité lui a été largement reconnue mais elle ne l’a pourtant pas empêché d’édifier une œuvre quantitativement considérable et on ne peut donc pas dire qu’elle fut un frein à l’écriture. En vérité, pour lui comme pour ceux qu’il appelait ses « chers camarades », il ne s’agissait pas seulement d’une affaire de morale personnelle et de noble refus de toute mesquinerie dans les rapports humains. Cette attitude renvoie à une humilité plus profonde qui apparaît comme une désacralisation de l’artiste tout puissant et de son œuvre, dont la vocation avouée serait d’emprisonner la totalité du monde dans sa propre expérience. Auric, réformé de l’armée, dans les derniers mois de la Grande Guerre, se disait « évadé d’Allemagne » et la métaphore est transparente. L’ambition globalisante des grands systèmes, dont la musique et la philosophie allemandes sont les exemples les plus écrasants, est précisément ce que lui-même et ses pairs ont toujours rejeté. Et l’allergie s’est manifestée très tôt, dès les années d’apprentissage de la composition chez Vincent d’Indy à la Schola Cantorum. La dimension messianique de l’artiste lui semblait aussi suspecte que la fidélité aux grandes formes du langage musical classique. Il y avait dans son esprit une volonté d’effacement de l’individu devant l’art lui-même, laissant libre la capacité de jouir de sa puissance, en considérant presque comme secondaire le fait qu’elle s’exprime au travers de ses propres facultés, ou au travers de celles d’un autre. Le paradoxe de l’artiste tiraillé entre le Nous et le Je, était alors nié au profit d’une vérité supérieure qui, dépassant les protagonistes du moment, avait une vie propre, laissant au poète la tâche d’en dégager les contours plutôt que d’en construire laborieusement et orgueilleusement l’essence. Une semblable révolution, dira-t-on, avait déjà eu lieu, dont Ravel et Debussy avaient été, dans le domaine musical, les plus illustres porte-parole. Mais il s’agissait cette fois d’aller encore plus loin dans l’anéantissement des formes sublimées de la subjectivité en élargissant la brèche ouverte par Stravinsky.
Les choix esthétiques sont ici indissociables d’une exigence morale qui confine au religieux. Les charmes et les philtres wagnériens, et même debussystes, sont repoussés avec autant de vigueur que l’esprit de système dénaturé par l’académisme. Car il s’agissait de briser des sortilèges; et les plus somptueux clairs-obscurs de l’impressionnisme risquaient, en perdurant, de dégénérer en un habillage factice du mystère, qui deviendrait à son tour un refuge pour les fausses valeurs de l’ordre bourgeois. L’invisible n’était pas nié mais il devait apparaître sans fard, en pleine lumière, dans la clarté de l’innocence, car, disait Cocteau : « le mystère commence après les aveux. L’hypocrisie, la cachotterie qu’on a coutume de prendre pour le mystère, ne font pas une belle ombre ».
Pourtant, nous l’avons dit, Auric n’était pas un croyant. Il recherchait avidement la compagnie des hommes de foi sans partager leurs convictions, en restant toujours sur le seuil d’une révélation qui lui était refusée. Un doute tenace combattait sans relâche son attirance pour la vie spirituelle des chrétiens. Comme tous les hommes hantés par le doute, il fut insaisissable pour les amateurs de schémas simples. Le cas de Poulenc, par exemple, hésitant toute sa vie « entre le moine et le voyou », n’offre pas, de ce point de vue, la moindre difficulté d’interprétation. Mais la permanence d’une aspiration jamais comblée et jamais en repos décourage vite cette catégorie d’hommes que Jankélévitch appelait les « lourdauds ». C’est pourtant cette recherche qui se situe toujours « aux confins de … » qui donne à l’œuvre d’Auric tout son prix. Dans la liste non exhaustive que nous avons dressée de ses amitiés, les fils se rejoignent plus sûrement qu’on ne pourrait le penser en n’y jetant qu’un coup d’œil superficiel. Il est vrai que, de prime abord, on peut ne pas voir le rapport entre l’esprit du Bœuf sur le toit et celui de la Grande Chartreuse, entre la table des Maritain à Meudon et le brouhaha des brasseries de Montparnasse où se mitonnait la dernière provocation des conspirateurs du mouvement Dada ou du Surréalisme. Et pourtant il y a tout lieu de croire que des personnalités comme Stravinsky ou Nadia Boulanger ne s’en seraient nullement étonnées. Les coups de mauvais garçons, qui avouaient souvent un goût du canular ou de la blague de potache ne peuvent être réduits à un simple défi lancé à la société. Ils expriment une soif de pureté, celle de l’origine, celle de l’enfance du monde, occultée par les ors d’un art ritualisé et officialisé. Pour les musiciens il s’agissait de suivre l’exemple – ou le contre-exemple – de Satie qui, selon Cocteau, craignait par dessus tout de « tomber dans le travers des maîtres : se trouver beau et s’en émouvoir ». Le scandale est grave dans la dérision et par la dérision. Et pour Auric il n’est pas éloigné du « blasphème par amour » de Bloy. Parce qu’il ne s’attaque pas seulement aux repus et aux tièdes mais aussi et surtout à ceux qui ont tué en eux cette fraîcheur d’âme qui est la source unique à laquelle s’abreuvent les saints et les poètes. Ces disciples de Caïphe étaient les seuls ennemis déclarés que cet être doux s’était choisis.
Une dialectique de l’exubérance et de la concision, de la légèreté et du tragique, de la couleur et de la blancheur, se développe après la Première Guerre mondiale, qui accentue une tendance déjà présente depuis les années du tournant du siècle. Plus qu’un mouvement lié à l’euphorie qui suit les conflits, elle est une arme, avec ses nécessaires prolongements politiques, contre les fausses vérités des marchands de gloire qui ont fastueusement orchestré le premier et inconcevable massacre de masse. C’est l’époque où un grand vent du large vient balayer les certitudes du vieux continent. Les Amériques, celle du jazz ou celle des Saudades de Darius Milhaud, débarquent dans les bagages des vainqueurs. C’est aussi l’époque où la force immobile et intemporelle des arts primitifs achève d’investir le monde de la peinture et de la sculpture comme celui de la danse, et vient nourrir le rêve d’une humanité plus proche du jardin d’Eden, et moins assurée de la supériorité incontestable de sa science. On aurait tort d’opposer l’explosion libératrice des années folles à l’attirance pour un art économe de ses séductions. Là encore la contradiction n’est qu’apparente. Les deux tendances révèlent la même ambition : celle d’arracher le masque qui dissimule le vrai visage de l’être humain. Elles sont les deux pôles d’une même planète, habitée par l’Enfant Roi, sérieux dans ses jeux et joueur jusque devant la mort, qui ne cache ni ses désirs, ni ses peurs, ni ses fragilités derrière les artifices de la connaissance, et dont la grâce infiniment mystérieuse échappe à toute image réfléchie et préméditée. Sa présence est légère, non parce qu’elle est superficielle mais parce qu’elle ne pèse pas. Rappelons l’anecdote bien connue de la première de Parade, quand Cocteau et Picasso entendirent un bonhomme très digne dire à sa femme : « si j’avais su que c’était si bête j’aurais amené les enfants ». Tout est dit ici, en une phrase, sur l’idée que le Bourgeois éternel se fait à la fois de l’art et des enfants. Tout est dit sur la nature des batailles livrées en ce temps-là. La grâce, dans les deux acceptions du terme, est poursuivie dans le souvenir de Nijinski et dans l’amour porté à l’art naissant de Chaplin. Le clown, celui de Rouault ou celui de Picasso, rejoint le danseur et l’acrobate sur la piste d’un cirque où se joue désormais le spectacle du monde. Et dans l’échange des masques l’illusion n’est pas du côté de celui qui est grimé. Cocteau, dans sa Lettre à Jacques Maritain, encore hanté par le souvenir de la mort de Radiguet, insiste sur ce point : « j’affirme que c’est l’enfant qui m’a vu en vous. L’enfant a vu l’enfant, ainsi les enfants se dévorent des yeux d’un bout à l’autre d’une table de grandes personnes ». Plus loin, à propos de Satie, il écrit : « nous le vîmes substituer la forme au reflet des formes et nous apprendre que ce qui est grand ne peut avoir l’air grand, ce qui est neuf avoir l’air neuf, ce qui est naïf avoir l’air naïf. Il nous enseigna que les vrais artistes sont des amateurs, c’est-à-dire des hommes, selon la parfaite définition du dictionnaire Larousse, qui aiment la poésie sans en faire profession. – Il nous donnait la clef des songes et le programme de notre tâche. » Enfin, dans les dernières pages, il livre cette profession de foi : « J’apprendrai que l’art est religieux et montrerai les dangers de l’art religieux. Je communiquerai la force des petites choses et le dégoût de la pompe qui est un mirage du démon pour nous faire perdre contact, à travers les siècles, avec la faiblesse humaine… »
C’est Auric qui introduisit Cocteau auprès de Maritain. Et c’est Maritain qui veilla Satie dans ses derniers jours. Ainsi se trouvent réunies trois influences majeures : celle des « chrétiens des premiers temps », celle du poète qui s’élançait sur la corde raide et celle du musicien qui, remerciant Dieu « qui nous laisse jouer avec ses affaires », fut drôle par humilité. Les multiples métamorphoses de l’art d’Auric ne s’éloignèrent qu’en apparence de ce triptyque de sa jeunesse. Elles furent en réalité une manière de lui rester fidèle en creusant le sillon initié à cette époque. La réconciliation manquée de l’art et de la Vérité le distingue sans l’opposer. Il a compris mieux que personne les régions que Satie voulait explorer mais sans le suivre jusqu’au stade ultime de son itinéraire spirituel. S’il a teinté, lui aussi, sa musique de touches ironiques, celles-ci furent moins l’habillage d’une pudeur des sentiments que l’aveu d’une impossibilité d’atteindre un quelconque socle de vérité. Ce qui l’attirait chez Satie c’était l’éthique que traduit la maigreur et la nudité des lignes qui ne cachent rien de leur nature interrogative et qui confèrent à l’humour un statut énigmatique. Cette affinité rejoint une autre révélation, plus tardive et peut-être encore plus significative : celle de la musique d’Anton Webern. La vérité se dérobant, reste l’espoir d’en recueillir des traces, en repoussant les muses épaisses et fatiguées d’un art qui se ment à lui-même. On ne saurait, par ailleurs, déduire de cet aspect fondamental de sa personnalité la tentation de promouvoir une esthétique de l’austérité, car celle-ci serait la plus dangereuse de toutes les prisons de la pensée qui furent précisément la cible de ses combats. L’extraction du minerai le plus pur exige au contraire qu’on laisse proliférer les forces qui ont rendu possible sa formation. Auric fut sur ce point à l’unisson de la plupart des artistes de la première partie du siècle. C’est la raison pour laquelle les explosions de vie, les crises et les polémiques furieuses ont toujours été bien accueillies par cet être secret et sobre, de même que les séismes sociaux et politiques, ou les avancées des techniques. Le mouvement était désiré parce qu’il épousait les formes éternellement changeantes de son questionnement et nul snobisme n’entacha sa sympathie infatigable pour la nouveauté. Celle-ci était toujours bienvenue puisqu’elle prolongeait la quête et permettait l’émergence de beautés parcellaires; même quand elles semblaient, comme chez Webern, n’être plus que les ultimes éclats d’une matière épuisée. L’audace était une loi morale, presque un précepte religieux, une virtuosité de l’âme en équilibre entre bravoure et humilité, sciences et candeur, un donquichottisme qui ne s’arrêtait pas en chemin pour se contempler. L’affût et la curiosité, sans censure ni préjugé, ont ainsi poussé Auric vers une évolution constante de son langage musical, qui ne fonctionnait pas sur le mode du reniement de ses recherches passées mais qui se refusait à poser un regard satisfait sur ce qui avait déjà été accompli. Une trouvaille, fût-elle géniale comme chez Stravinsky, n’était ni un point d’arrivée, ni un filon à exploiter habilement, mais la condition et la résultante d’une sorte de nomadisme de l’esprit qui maintenait celui-ci dans un état de permanente vigilance. Auric, comme Stravinsky à la fin de sa vie, bien loin des années des Ballets Russes, pouvait reprendre à son compte la leçon de Cocteau : « J’apprendrai que le besoin de changer en art n’est pas autre chose que celui de chercher une place fraîche sur l’oreiller. Poser la main sur une fraîcheur, elle cesse vite de l’être ; le neuf est une fraîcheur. Le besoin de neuf est une fraîcheur. Dieu est la seule fraîcheur qui ne se réchauffe pas. J’apprendrai qu’il importe de changer d’opinion sans crainte de se contredire. Autant de périodes, autant de points de vue. » L’œuvre d’Auric, à la fois chronique d’un temps et reflet de ses errances dans son rapport à la notion de vérité, en art, en politique ou en religion, à la fois ambitieux et humble, et, regardant toujours en avant, défie la notion d’achèvement et induit l’idée que le questionnement n’aurait peut-être pas de fin.
Cette œuvre emprunte à divers systèmes et courants esthétiques sans jamais se fixer définitivement et sans que se perde la singularité du regard de son auteur sur le monde. Et ce regard est celui de quelqu’un qui passe. La fidélité est là, mais le voyage continue. Certains prendront ainsi ombrage d’un partage de l’amitié qu’ils interpréteront à tort comme un éloignement, mais capituleront vite devant la douce fermeté qui leur sera opposée. La première partie de la carrière d’Auric, sans doute la plus connue, est liée à la légende des Ballets Russes, à celle de la naissance du Groupe des Six et au cercle des peintres et des poètes avec lesquels il travailla. C’est l’époque où il participait, comme pianiste, à la création des Noces de Stravinsky, où Diaghilev lui commandait Les Fâcheux et Les Matelots, où Georges Braque lui prêtait son concours pour les décors. C’est la période dont nous avons parlé, du retour à la clarté de la texture et de la forme, celle du rejet de tous les « ismes ». Les années 30 l’entraîneront encore plus résolument vers l’avant-garde, à la fois sur le plan de la démarche artistique et sur celui des idées générales. La montée des extrêmes droites européennes était alors la réaction attendue et redoutée aux vraies et aux fausses insouciances des années folles, et un front antifasciste réunissait naturellement un grand nombre d’artistes et d’intellectuels. Influencée par la victoire, en France, du Front Populaire, la sonate pour violon et piano est révélatrice d’une tentative de réconciliation entre musique populaire et musique savante bien dans la ligne des réflexions d’alors sur l’art et sa fonction sociale. La Sonate pour piano fut par contre une œuvre de rupture, très novatrice, tournant le dos à tout ce que le compositeur avait écrit auparavant, et parfaitement incomprise lors de sa création. En contrepoint de ses recherches, Auric, dans le sillage de Cocteau, se tourna vers le théâtre et surtout vers le cinéma. Cette dernière activité ne fut pas subalterne et alimentaire. Elle fut une autre manière d’épouser le mouvement de son temps et d’associer ses ambitions musicales et poétiques au développement de cet art populaire par excellence qu’était le cinématographe. Il collabora avec Cocteau pour Le sang du poète et L’Eternel retour, et avec René Clair pour A nous la liberté. Il ne cessera d’écrire pour l’écran et la valse de Moulin Rouge composée d’un trait pour le film de John Huston, fit le tour du monde et devint une de ces mélodies que l’on fredonne partout sans se soucier du nom de son auteur, semblable à ces contes éternels dont l’origine est oubliée. Après la Deuxième Guerre les tendances les plus expérimentales de son art s’accentuèrent et explorèrent différents registres. Les ballets Phèdre ou Le peintre et son modèle, combinent une violence rythmique et une rutilance d’orchestration qui témoignent de la puissance de la maturité. Les projets ont les moyens de leurs ambitions et le ton s’affirme. En même temps l’attirance pour l’abstraction reprend ses droits et l’influence de l’Ecole de Vienne apparaît dans Chemin de lumière, la Partita pour deux pianos, et plus tard dans la série des Imaginées. Les derniers vestiges du langage tonal s’effacent peu à peu et les apports de la musique sérielle se font de plus en plus présents. Il recherchait alors la compagnie des jeunes musiciens, non pour leur prodiguer des conseils sur un ton protecteur, mais au contraire pour se mettre à leur école et pour respirer à leur contact l’air pur des débuts, quand tout paraît encore possible et que de nouvelles découvertes semblent à portée de main. Il est remarquable qu’Auric ait su, au sein d’une production polymorphe, garder toujours son individualité; présence tenace et discrète comme le fut sa place dans le monde et qui renvoie, à travers l’œuvre entière, les échos d’une nature moins affirmative qu’introspective. L’ultime et admirable recueil des Imaginées hésite devant le point final, lui préfère le point de suspension, et se refuse à refermer avec solennité la parenthèse d’une vie. Comme si celle-ci n’était qu’un passage de plus. Malgré les honneurs et les postes officiels, Auric resta jusqu’au bout ce « promeneur des deux rives » qui naviguait, au temps de sa jeunesse, entre Montmartre et Montparnasse, entre des univers séparés parfois par bien autre chose qu’un fleuve, mais qu’il savait relier entre eux en suivant la trame invisible d’une conscience exigeante et perpétuellement en éveil.
ψ ψ ψ
J’ai rencontré Georges Auric pour la première fois au début des années 70. C’était au cours d’une soirée de mélodies donnée dans le cadre du festival d’Aix-en-Provence. Le vieux maître était l’hôte d’honneur du concert au cours duquel Hugues Cuenod et Christian Ivaldi interprétaient le Socrate de Satie. Il écoutait l’œuvre les yeux mi-clos, sensible plus que tout autre aux résonances de la musique et de la mémoire. Tout le monde avait à l’esprit qu’il était le seul dans l’assistance à avoir été au cœur de la création de Satie et sa présence donnait à l’événement un certain caractère de gravité. Ce rôle de grand témoin l’eût certainement gêné, s’il n’était resté parfaitement extérieur à tout ce qui n’était pas le déroulement d’un texte qu’il connaissait par cœur depuis bien longtemps, et qu’il ne se lassait pas de réentendre. Je n’avais pas vingt ans et, à l’issue du concert, j’hésitais à aller saluer cet homme très entouré. Mais il m’apparut que je devais le faire puisque j’avais le sentiment de le connaître déjà mieux que la plupart des invités. J’avais en effet entendu parler de lui durant toute mon enfance. Ma grand-mère était la fille de Léon Bloy et par ses récits j’étais devenu un peu un familier de ces soirées de Bourg-la-Reine où elle et Auric jouaient les sonates de Franck et de Lekeu pour le vieil écrivain et ses amis. Et je l’avais entendue raconter cette fin d’après-midi du 3 novembre 1917 où son père, selon les mots de Jeanne Bloy, « à l’heure de l’Angélus, sans râle et sans agonie, passa par la Porte des Humbles ». Auric était à son chevet et ce moment, qu’il évoque dans ses souvenirs sous le titre « J’ai vu vivre Léon Bloy et je l’ai vu mourir », avait été, je le savais, un des faits marquants de sa vie. Je me suis donc avancé, et j’ai pu en un éclair prendre la mesure de ce que l’écrivain avait pu représenter pour lui. Il devint presque pâle et tout d’un coup plus personne n’exista alentour à l’exception de ce petit-fils de Madeleine Bloy qui se tenait gauchement à ses côtés. Il m’emmena un peu à l’écart sous les regards étonnés des élégants délaissés et je sus que, malgré moi, j’avais fait démarrer le train du souvenir qui le ramenait aux journées de 1916 et 1917, quand avec Pierre van der Meer, Jacques et Raïssa Maritain, Georges Rouault ou encore Ricardo Viñes, il avait formé cette famille spirituelle dont Léon Bloy était le père, et dont le rayonnement est parvenu jusqu’à nous. Je suis allé le revoir par la suite chez lui, avenue Matignon. Je lui parlais de sa musique, de sa Sonate pour violon, et il me ramenait toujours à Bloy et à l’histoire de ma famille. J’ai gardé avec soin la partition de la Sonate qu’il avait dédicacée à mes grands-parents avec ces quelques mots bien dans sa manière : « A Madeleine et Edouard Souberbielle, en attendant mieux… »
Il m’importe d’ajouter que c’est grâce à lui que j’ai pu obtenir une bourse me permettant de poursuivre mes études à la Juilliard School de New York.
Aujourd’hui, il m’arrive d’aller travailler dans notre maison familiale de Meudon, dans cette même rue qu’ont habitée les Maritain, à peine quelques mètres plus loin. Mille fois je suis passé devant leur porte, franchie par tant d’hommes et de femmes illustres ou inconnus qui venaient, avant la guerre, goûter un peu de la paix de l’âme que ce couple unique savait dispenser. Les ramifications de l’héritage bloyen sont ainsi nourries de ces fausses coïncidences qu’illustre bien cette étonnante proximité géographique des lieux d’habitation. Et voilà qu’on me demande mon témoignage et que j’écris ces lignes à l’endroit précis où soixante dix ans auparavant Auric amenait pour la première fois Cocteau chez les filleuls de Léon Bloy. Je me souviens de son émotion quand il évoquait les heures de Bourg-la-Reine, de Meudon, ou d’Arcueil, chez Satie, et l’atmosphère de ces paisibles banlieues du sud de Paris qui constituaient le modeste décor de ces rencontres décisives. Un décor qui était à des années-lumière de ces quartiers « artistes » de la Capitale où même la misère participait de l’esthétique bohème et où il importait avant tout d’être vu. Ces pavillons de la périphérie furent probablement pour le jeune Auric, et plus encore pour l’homme âgé que j’ai connu, des lieux d’ancrage à partir desquels il pouvait affronter les frivolités et les aveuglements du monde sans perdre de vue l’essentiel. On s’est souvent posé la question de savoir ce qui avait pu l’attirer chez un homme comme Léon Bloy. Et comment cet être qui n’aimait pas les chapelles avait pu être si proche de ce bâtisseur de cathédrales, de cet enlumineur de la parole biblique pour qui la seule mission légitime de l’art était d’être l’écrin de la Révélation. Au début d’un siècle qui, d’entrée de jeu, proclama la mort de Dieu et travailla à la remise en question radicale de la notion de vérité, le bloc de foi indéracinable qu’incarnait Le Pèlerin de l’Absolu, qui semblait être à contre-courant du sens de l’Histoire, lui apparut non comme un simple contrepoids à son scepticisme mais plutôt comme le contrepoint indispensable à une polyphonie intérieure dominée par les voix obsédantes du doute. Et la dimension déraisonnable et « scandaleuse » de la conception qu’avait Bloy de la vie religieuse lui semblait seule capable de répercuter l’écho de son questionnement. L’écrivain fut pour lui le point fixe d’une époque changeante, une présence intemporelle qui l’arrimait à ce qui ne passe pas. Et parce qu’il l’avait aimé avant même de l’avoir compris, condition indispensable pour le comprendre, il lui fut donné en retour de recevoir, par-delà la force du souvenir, une source de lumière capable d’éclairer éternellement son jardin secret, celui vers lequel il se retirait toujours après que les dernières rampes de la salle de concert s’étaient éteintes. Ce jardin resta celui de l’interrogation et de la nostalgie. À la fin de sa vie il citait ce mot de Renan, que pourtant il n’aimait guère : « Il se pourrait que la vérité fût triste ». Et il se résignait d’autant moins à accepter cette hypothèse que celle-ci, à bien des égards, ne lui semblait pas impossible. L’art, sans donner de réponse, détournait la tristesse, témoignait du don gratuit du Beau dont la nature n’avait pas fait l’économie. Il était une impatience, peut-être un signe, et plaçait l’artiste devant sa responsabilité, devant la question de la signification de ses actes. Pour lui la splendeur du style de Bloy, que ce dernier jugeait nécessaire, était une face de la médaille dont Satie occupait l’autre versant ; l’épanchement et le sacrifice total de soi dans le feu de l’écriture répondant au dépouillement d’une expression minimaliste, et le rejoignant dans une même intransigeance en face des formes d’art vendues aux Marchands du Temple. Auric, comme compositeur, hésita entre ces deux pôles de la sensibilité qui forment l’axe autour duquel s’articule toute création mais il n’hésita pas, d’un point de vue moral, sur le chemin à emprunter alors même que sa destination finale lui restait cachée. Dans ce domaine son autorité ne put être prise en défaut et ce fut là sa grandeur.
ψ ψ ψ
Décembre 1999 – Le centenaire de sa naissance passa presque inaperçu. Le compositeur a rejoint ainsi une dernière fois ses camarades du Groupe des Six qui, à l’exception relative de Poulenc, ne sont pas encore sortis d’un purgatoire de près de trente ans où ils semblent expier durablement leurs succès de jadis. Les traces ont tendance à s’estomper mais il y a tout lieu de croire pourtant que leur démarche ne sera pas oubliée et que la gloire de l’éphémère qu’ils ont voulu célébrer ne sera pas indéfiniment retenue contre eux.
ψ ψ ψ
Un post-scriptum, mai 2018
Périgueux, automne 2017: cérémonies du centenaire de la mort de Léon Bloy (né dans cette ville le 11 juillet 1846). Tout au long de la journée, je suis aux côtés d’Alain Joubert. Dix-sept ans auparavant nous avions été mis en relation par l’intermédiaire de la violoniste Marie-Thérèse Ibos, un de mes premiers professeurs et, par ailleurs, la nièce du compositeur Louis Aubert. Alain me demandait mon témoignage sur Auric, et la brochure qui fut consacrée à ce musicien compte parmi les premières réalisations de l’association des Amis de la Musique Française. Une amitié bloyenne (Auric) avait été l’occasion de notre rencontre et sans doute incombait-il à Bloy de nous réunir à nouveau. Aujourd’hui, Alain est devenu un ami cher, et il a voulu rééditer notre brochure, qui me tient à coeur pour des raisons qui dépassent le cadre du souvenir. Il est de ceux qui se battent pied à pied contre le poison de l’indifférence et de l’oubli, et nombre de musiciens se voient à nouveau exposés en pleine lumière par la grâce de son action. En effet, la richesse des études et témoignages que publient les AMF, notamment sur Internet, invite à découvrir ou redécouvrir des musiques, mais elle encourage aussi la recherche. A ce double titre, les militants d’une telle cause méritent reconnaissance et gratitude. Pour ma part, je vérifie une fois de plus la parabole bloyenne selon laquelle ce sont toujours les gens avec peu de moyens qui agissent avec le plus de générosité, de promptitude et d’efficacité. C’est une loi d’ordre général, qui souffre bien peu d’exceptions, et que le travail magnifique d’Alain Joubert vient régulièrement nous rappeler. □
_________________________
[1] Le Coq et l’Arlequin
Portfolio

Georges Auric (1899-1983), compositeur français. Paris, vers 1950. Crédit : © PARISENIMAGES, Boris Lipnitzki/Roger-Viollet
Partager sur :

